L’aube du 21e siècle a vu l’émergence d’un nouvel acteur, à la fois omniprésent et furtif, sur les scènes de conflit à travers le globe : le drone. Autrefois relégués au rôle d’outils de surveillance ou de reconnaissance, ces aéronefs sans pilote sont devenus des instruments de guerre à part entière, transformant radicalement la nature des engagements militaires et soulevant de profondes questions éthiques et juridiques.
Ce qui distingue les drones modernes est leur polyvalence. Capables de voler pendant de longues heures, de collecter des renseignements avec une précision inégalée, et, surtout, de lancer des frappes létales à distance, ils offrent aux forces armées un avantage considérable. Les États-Unis ont été les pionniers dans l’utilisation des drones armés, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, pour cibler des groupes terroristes dans des régions reculées.
Le drone Predator et son successeur, le Reaper, sont devenus emblématiques de cette nouvelle ère de guerre, symbolisant une capacité à projeter la puissance aérienne sans risque direct pour les pilotes. « Les drones ont permis aux États-Unis de projeter leur puissance aérienne dans des zones où il était auparavant trop risqué ou politiquement coûteux d’envoyer des avions de chasse pilotés, » explique Sarah Kreps, professeure de droit et d’affaires gouvernementales à l’Université Cornell, dans son ouvrage Drones: What Everyone Needs to Know (2016). Elle ajoute que « ils ont réduit le risque pour les pilotes, mais ont en même temps rendu l’engagement militaire plus facile à justifier politiquement. »
L’utilisation des drones de combat n’est plus l’apanage des seules superpuissances ; elle s’est généralisée, témoignant de leur efficacité perçue et de leur accessibilité croissante. Les États-Unis demeurent le plus grand utilisateur historique de drones armés, ayant mené des milliers de frappes au Pakistan, au Yémen, en Somalie et en Afghanistan. Un rapport du Bureau of Investigative Journalism (BIJ) estime que les frappes de drones américaines au Pakistan ont coûté la vie à entre 424 et 969 civils entre 2004 et 2018, des chiffres qui restent toutefois contestés par le gouvernement américain.
Plus à l’Est, Israël, précurseur dans le développement des drones, les utilise intensivement ses modèles Hermes et Heron pour la surveillance et les frappes, notamment dans la bande de Gaza et au Liban. La Turquie, quant à elle, s’est imposée comme un acteur majeur dans la production et l’utilisation de drones, avec le succès retentissant du Bayraktar TB2. Ce dernier s’est distingué par son efficacité lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020, mais surtout en Ukraine depuis l’invasion de 2022. La BBC a d’ailleurs rapporté en mars 2022 l’impact significatif du TB2 sur les forces russes, citant des experts militaires qui soulignaient sa capacité à détruire des blindés et des systèmes de défense aérienne.
 Un Drone de US army des Etats unis d’Amérique
Un Drone de US army des Etats unis d’Amérique
Le conflit en Ukraine est devenu un véritable laboratoire pour l’utilisation des drones à toutes les échelles. Des petits drones commerciaux, adaptés pour la reconnaissance et le largage de grenades, aux drones de combat turcs et américains, leur présence est devenue omniprésente. « Le conflit ukrainien a démontré que même des drones relativement peu coûteux, utilisés de manière créative, peuvent avoir un impact stratégique majeur, » a souligné Michael Horowitz, professeur de sciences politiques à l’Université de Pennsylvanie et spécialiste de la technologie militaire, lors d’une interview pour le Council on Foreign Relations en 2023. Cette guerre a également mis en lumière l’importance des drones pour la surveillance, le ciblage de l’artillerie et même la guerre psychologique, redéfinissant les tactiques sur le champ de bataille européen.
Parallèlement, la Chine développe activement sa propre technologie de drones, y compris le Wing Loong, qu’elle exporte vers plusieurs pays, marquant une expansion de la compétition technologique dans ce domaine crucial.
Défis éthiques et juridiques : l’ombre d’une guerre à distance
L’essor des drones de combat a inévitablement soulevé un débat houleux concernant leur légalité et leur moralité, jetant une ombre sur cette « guerre à distance ». La question des victimes civiles demeure centrale. Malgré la précision prétendue des drones, les allégations de dommages collatéraux persistent. La nature même de la guerre menée à des milliers de kilomètres peut créer une déconnexion psychologique entre l’opérateur et la cible, potentiellement augmentant le risque de tragédies civiles. De plus, les frappes de drones sur le territoire d’États souverains, sans leur consentement explicite, soulèvent de vives interrogations sur la souveraineté des États et la violation potentielle du droit international.
Un autre défi majeur est celui de l’escalade et de la prolifération. La facilité relative d’utilisation des drones pourrait, selon certains experts, abaisser le seuil d’engagement dans les conflits, rendant les interventions plus fréquentes et les dynamiques régionales plus complexes à maîtriser à mesure que de plus en plus d’acteurs acquièrent ces technologies.
 Un drone armé au Battle Lab Terre
Un drone armé au Battle Lab Terre
L’un des débats les plus pressants concerne l’autonomie létale des systèmes d’armes. Les « systèmes d’armes létales autonomes » (LAWS), communément appelés « robots tueurs », qui pourraient sélectionner et engager des cibles sans intervention humaine significative, représentent une frontière technologique et éthique critique. « La question des LAWS est l’une des plus importantes de notre génération en matière de sécurité internationale. Nous devons établir des limites claires avant qu’il ne soit trop tard, » avertit Toby Walsh, professeur d’intelligence artificielle à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud et ardent défenseur de l’interdiction des LAWS, dans son livre 2062: The World that AI Made (2018).
Les drones ont redéfini la guerre moderne. Ils offrent des avantages indéniables en termes de renseignement, de précision et de réduction des risques pour le personnel militaire, comme en témoigne leur rôle pivot en Ukraine. Cependant, leur utilisation soulève des préoccupations profondes quant à la protection des civils, au respect du droit international et à l’avenir de la guerre elle-même. /
Alors que la technologie continue d’évoluer à un rythme effréné, la communauté internationale est confrontée à la tâche urgente d’établir des normes claires et des cadres éthiques pour encadrer l’utilisation de ces outils puissants, afin de s’assurer que l’innovation militaire ne l’emporte pas sur les impératifs humanitaires et juridiques. L’équilibre entre l’efficacité militaire et la responsabilité éthique sera le défi majeur des décennies à venir.
Source : Le Soleil









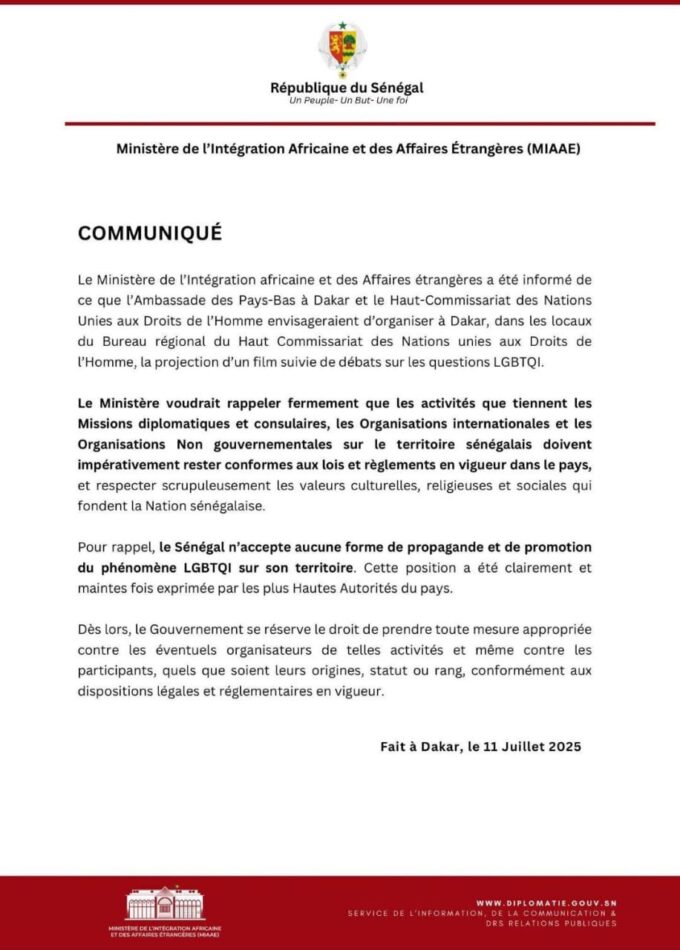


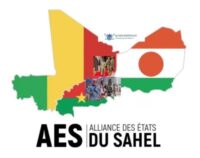
Laisser un commentaire